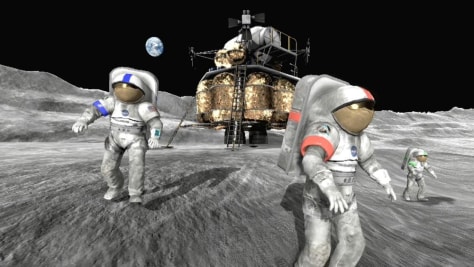'A Bucketful of Sugar' by Lee Nachtigal via Flickr . Image is licenced under a Creative Commons Attribution licence
Depuis quelques temps, notre jeunesse est occupée à d’étranges jeux. Dans l’un d’eux, il doivent superposer des parallélépipèdes de bois de 10 centimètres de longueur et de 5 millimètres d’épaisseur. Le jeu consiste à empiler la plus grande hauteur possible ou encore de copier des motifs. On peut aussi les voir jouer avec des personnages de plastique, inventant des histoires à partir de ces objets inertes. Dans les cours de récréation, on ne joue plus à Nintendogs ou à Legend of Zelda mais au Loup ! Les enfants se courent après et doivent “s’attraper”. Pris dans l’excitation du jeu, il arrive que certaines saisies et certaines poussées soient trop brutales et, inévitablement, les cas d’accident se multiplient.
Il n’y a rien de moins créatif que ces jeux, et les parents devraient s’alarmer de ce que leurs enfants se détournent ainsi de ce qui consiste le cœur de nos sociétés. Voire toute une génération refuser l’héritage de ses pères en tournant le dos aux matières numériques qui ont donné à la fois tant de beauté et tant d’intelligence à nos civilisations est véritablement alarmant.
Jusqu’ici, nous avons bâti notre culture sur le numérique. Ses capacités de stockage infini, la possibilité d’éditer tout objet et de le transformer, la possibilité de sauvegarder et de détruire et celle de partager avec d’autres les objets ont été les éléments sur lesquels nos savoirs se sont construits et transmis. Ce qui circule ainsi dans nos sociétés, ce ne sont pas seulement des bits mis en lien par le réseau. Ce qui est au cœur de notre culture, c’est la complexité, et c’est de cette complexité que le numérique est à la fois le vecteur et l’image.
Une simple quête de Legend of Zelda ou de World of Warcraft fait surgir succession de quêtes emboitées les unes dans les autres. Il faut se souvenir des lieux, de la chose à faire, des personnages. Il faut construire la narration, il faut élaborer des hypothèses, il faut construire des stratégies. La complexité augmente encore lorsque l’on joue en multijoueur puisqu’il faut accorder les délicats mécanismes sociaux pour pouvoir réussir la quête.
Voila que maintenant des enfants tournent le dos aux apprentissages premiers de la complexité ?
Quels types d’adultes est ce que ces enfants deviendront ? Déjà, des spécialistes parlent d’addiction au off. Il s’agit de personnes passant un temps considérable dans des activités qui n’ont rien a voir avec le numérique, et qui éprouvent le besoin de se déconnecter. Ces enfants ne sont plus occupé par leurs réseaux sociaux. Ils ne socialisent plus. Ils n’apprennent plus rien. Ils se perdent dans des mondes de sensations. Ils ne sont plus au contact avec la complexité et la diversité. Ce que le off leur apporte, c’est un monde simplifié.
On peut comprendre ce que cette simplification peut avoir d’attrayant sur les âmes les plus jeunes. Les enfants ont en effet toujours tendance a privilégier le plaisir le plus immédiat. Ils ne voient pas les gains du dur farming et du hardcore gaming. A l’extrême complexité des mondes numériques, il préfèrent l’immédiate simplicité de la réalité.
Il n’est pas besoin d’être un grand spécialiste en psychologie pour comprendre l’attrait que le off exerce sur les plus jeunes et les plus faibles. Le contact direct, non médiatisé, procure d’immenses plaisirs qui sont d’autant plus préjudiciables que l’immaturité de l’enfant ne lui permet pas d’y faire face. Aux médiations numériques se substituent l’accès immédiat à des objets qui suscitent des sensations d’autant plus fortes qu’elles touchent ce que notre système nerveux à de plus archaïque. Bien évidement que toucher, courir, ou faire usage de sa force sont des choses plaisantes. Mais, ces plaisirs doivent être maitrisés, et surtout, ils ne doivent pas occuper tout le temps de l’enfant !
Est-il besoin de stimuler avec tant de force nos instincts les plus bas ? Et, encore une fois, quel avenir nous préparons nous en laissant nos enfants être ainsi sur-stimulés sans médiation ?


 Verra-t-on un jour des médecins prescrire des GTA ou des Gran Turismo –like à leurs patients ? C’est possible. En effet, une étude conduite par Adam Gazzaley montre que des personnes âgées entre 60 et 85 ans obtiennent de meilleurs scores sur différents tests cognitifs après avoir jour à un jeu vidéo appelé “NeuroRacer”
Verra-t-on un jour des médecins prescrire des GTA ou des Gran Turismo –like à leurs patients ? C’est possible. En effet, une étude conduite par Adam Gazzaley montre que des personnes âgées entre 60 et 85 ans obtiennent de meilleurs scores sur différents tests cognitifs après avoir jour à un jeu vidéo appelé “NeuroRacer”