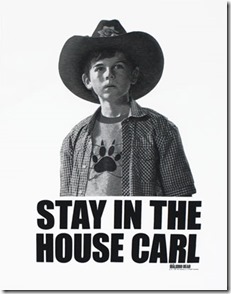Le Code de Bonne conduite de Janell Burley Hofmann est devenue en quelques jours une curiosité de l’Internet avec plus de 25K likes et 1500 tweets. Il signale l’inquiétude des parents vis à vis des usages que les adolescents ont de l’Internet. Malheureusement, il souligne surtout les préjugés d’une mère qui pense que la conversation téléphonique est quelque chose de moins que la conversation en face à face, craint la pornographie, exige que son fils réponde à chaque appel, ne comprend pas l’intérêt de capter des images ou d’écouter la même musique de des millions d’autres adolescents
Si vous souhaitez que votre enfant grandisse dans votre périphérie immédiate et ne développe aucune autonomie, c’est le bon guide a appliquer. Il suffit de suivre ces règles suffisamment longtemps pour arriver à ce résultat.
Si votre objectif est de concourir à la construction d’une personne libre, prenant des décisions seule, assumant le risque d’un échec dans ses entreprises, alors il faut faire autrement.
Voici les règles que je propose. Elles sont biaisées idéologiquement : je pense que les enfants n’appartiennent pas aux parents, que le travail de ceux-ci est de les aider à grandir, Je reconnais que cela prend du temps, de l’énergie, de l’angoisse et de l’argent, mais ce n’est pas une raison pour enfermer l’enfant dans des règles qui ne font qu’aménager le confort des parents. Deuxièmement, je pense que l’enfant est un être autonome depuis sa première respiration. Le travail des parents est d’assister l’enfant pour qu’il garde cette autonomie. C’est un travail difficile, tant l’enfant et les parents peuvent avoir de “bonnes” raisons et du plaisir à réduire cette autonomie
Voici les règles.
Règle 1. Le téléphone appartient à l’adolescent. Les parents ne sont pas autorisé à fouiller l’historique des appels, a explorer ses photographies, a contrôler ses navigations sur Internet, ou à checker son compte Facebook.
Un téléphone portable n’est pas qu’un téléphone portable. C’est une plateforme sociale et un espace privé. Il ne viendrait pas a l’esprit de parents d’écouter à la chambre de leurs enfants. C’est pourtant ce qu’ils font lorsqu’ils surfent sur les profils Facebook des amis de leurs enfants. Il pénètrent également dans la vie intime de leur enfant, à une époque ou la constitution d’espaces personnels, privés, loin du regard des parents est primordiale. Cette construction se fait avec des difficultés, des excès, des accros de la part de l’adolescent, et c’est pour cette raison qu’il est impératif que les parents n’interfèrent pas.
Règle 2. Le téléphone portable n’est pas une laisse.
L’enfant n’est pas obligé d’envoyer un SMS lorsqu’il arrive à la maison, ou de répondre aux appels des parents. La raison en est simple. Les parents n’ont pas a faire peser sur leurs enfants leurs angoisses de séparation. Reconnaitre le temps propre de l’enfant, c’est reconnaitre son autonomie. Les appels manqués seront objets de discussion pour comprendre la situation de l’enfant : qu’est ce qui l’empêche de répondre. C’est pour les parents, plus qu’un motif de colère, un excellent thermomètre des relations que leur enfant a avec eux
Règle 3. Le téléphone portable n’est pas un otage
L’utilisation du téléphone portable ne doit pas être soumis aux aléas relationnels que les parents vivent avec leur adolescent. D’une part, parce que il n’est pas possible de prendre ce qui a été donné, ou alors on part de l’idée qu’aucune parole ne vaut, et que tout peut être remis en question simplement parce que un parent l’a décidé. Après avoir “repris” le téléphone, il sera peut être possible de reprendre des vêtements, où le mobilier de la chambre ? Pourquoi pas des livres ? Ensuite, parce que donner des punitions à un enfant, ce n’est pas l’élever mais le rabaisser (et se rabaisser soi-même)
Il faut prendre conscience que le système des punitions est inefficace ou contre-productif. Lorsqu’un enfant est “éduqué” à coups de punition, il a deux stratégies possible. Soit il se soumet – et si vous voulez élever un être autonome, vous avez manqué votre objectif. La seconde stratégie est encore pire : l’enfant renonce à ce qu’il aime et ce qui est important pour lui. Il se détache des objets que ses parents lui retirent. Mais il se détache également de ses parents. Dans les deux cas, c’est perdu-perdu.
Parents, seriez-vous prêts à signer cette charte ?
![images[1] images[1]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgj6DQFyOm6HJojvcXcw60-qOjM_llkvuyR8L2or8mSL-xmaBvagyNmuD31FBdopRGXb4qy7eRfFBK472JtIx86fqgMRMSMboroWAqZbsfTD21_kSG_5VjyWbOtf_XqkGz0ZXFs9ILWClc/?imgmax=800)